Une
antenne de l’USJ de Beyrouth à Abou Dhabi
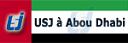
Trois formations y seront
dispensées en arabe, en français et en anglais.
Comme
suite à un accord signé avec le Centre
of Excellence for Applied Research and Training (CERT),
un organisme relevant du ministère de l’Enseignement
supérieur d’Abou Dhabi, l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth (USJ), au Liban, créera
une antenne dans l’émirat du Golfe.
L’Université
Saint-Joseph y installera une filiale de son École
de traducteurs et d’interprètes, un institut
de formation ortho-pédagogique
ainsi qu’une formation en actuariat.
Ces
formations, qui seront suivies de plusieurs autres filières,
seront dispensées en trois langues : l’arabe,
le français et l’anglais.
La
formation académique sera assurée par
l’Université Saint-Joseph, notamment par
des professeurs sur place et également par des
professeurs visiteurs, tandis que l’administration
et la logistique seront assumées par le CERT.
Les
diplômes qui seront délivrés seront
ceux de l’USJ.
Selon
les responsables de l’Université Saint-Joseph,
c’est grâce à la tenacité et
aux efforts de la Fédération des anciens
de l’USJ à Abou Dhabi
que l’on doit la création de cette antenne
universitaire.
Sur
quelque 200 000 Libanais qui travaillent dans la région
du Golfe, 60 000 sont installés à Abou
Dhabi. Ils seront les premiers bénéficiaires
de cette initiative.
Après
l’Université de Paris-Sorbonne qui a installé
un campus à Abou Dabi en octobre 2006, l’Université
Saint-Joseph est la deuxième université
de langue française à s’ouvrir une
fenêtre sur le Golfe.
Abou
Dhabi achète tous azimuts et se pose en concurrent
de Dubaï
Septembre
2008-
Fort de son immense richesse pétrolière,
l’émirat d’Abou Dhabi, qui a acheté
la semaine dernière un grand club anglais de
football et annoncé un investissement d’un
milliard de dollars dans le cinéma, fait feu
de tout bois pour s’imposer sur la scène
mondiale.
Dopé par des recettes pétrolières
record du fait de la flambée des cours du brut,
Abou Dhabi, le plus riche des sept membres de la Fédération
des Émirats arabes unis, multiplie aussi les
investissements sur le plan local au point de se poser
en rival de Dubaï, engagé dans des projets
monumentaux, comme la plus haute tour du monde et trois
îles artificielles en forme de palmiers.
Longtemps dans l’ombre de cet émirat voisin,
Abou Dhabi s’est lancé dans des investissements
tous azimuts après la mort en novembre 2004 de
son souverain, cheikh Zayed ben Sultan al-Nahyane, également
fondateur et premier président des Émirats.
Abou Dhabi a d’abord misé sur la culture
et le tourisme haut de gamme en attirant, moyennant
finance, la prestigieuse université française
de la Sorbonne – qui a ouvert en 2006 une branche
à Abou Dhabi – puis le musée du Louvre.
L’ouverture du « Louvre Abou Dhabi »
est prévue en 2012.
Un parc à thèmes, dédié
aux studios Warner Brothers, a aussi été
annoncé et l’émirat prépare
un « Ferrari World » qui comportera dès
2009 un circuit de formule 1. Abou Dhabi organisera
ainsi à partir de l’an prochain un Grand
Prix.
Les responsables d’Abou Dhabi ne lésinent
pas sur les moyens pour faire parler de leur émirat
: une nouvelle compagnie, Imagination Abu Dhabi, a ainsi
été lancée mercredi dernier avec
pour mission d’investir un milliard de dollars
pour la production de 40 films sur les cinq prochaines
années, en partenariat avec les plus grandes
firmes de Hollywood et Bollywood, afin de faire d’Abou
Dhabi une place forte de l’industrie du film.
Cette initiative a été révélée
deux jours après l’entrée remarquée
de l’émirat dans le monde du football, avec
l’annonce de l’acquisition de Manchester City,
club qui a engagé le même jour le Brésilien
Robinho, 24 ans, en provenance du Real Madrid, pour
42 millions d’euros (près de 61 milliards
de dollars).
L’acquisition a été faite par l’Abu
Dhabi United Group for Development and Investment, un
groupe d’investisseurs privés dirigé
par cheikh Mansour ben Zayed al-Nahyane, ministre des
Affaires présidentielles et frère du chef
de l’État des Émirats.
Le nouveau patron de Manchester City, le milliardaire
émirati Sulaiman al-Fahim, qui veut faire du
club le plus grand du monde, a même affirmé
mardi dernier qu’il était prêt à
débourser jusqu’à 165 millions d’euros
pour s’assurer les services du Portugais Cristiano
Ronaldo, qui joue pour Manchester United, le principal
club de la ville.
L’ambition semble désormais sans limite
dans cet émirat dont le souverain, cheikh Khalifa
ben Zayed al-Nahyane, également président
de la fédération, figure, avec une fortune
estimée à 23 milliards de dollars, au
deuxième rang des têtes couronnées
les plus riches du monde, selon un récent classement
du magazine américain Forbes.
Le principal fonds souverain de l’émirat,
l’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), doté
de quelque 875 milliards de dollars, est aussi le premier
au monde.
Il est devenu en novembre 2007 l’un des principaux
actionnaires de la banque américaine Citigroup
en injectant 7,5 milliards USD dans cet établissement
affaibli par la crise des « subprimes »
(crédits hypothécaires à risque).
Fin septembre 2007, il avait acquis 7,5 % de Carlyle,
l’un des plus gros fonds d’investissement
américains, pour 1,35 milliard de dollars, et
aussi investi 500 millions dans un fonds détenu
par Carlyle, qui, comme Citigroup, a été
gravement touché par la crise des crédits
hypothécaires.
Mais Abou Dhabi investit aussi dans l’électronique.
L’émirat a acquis en novembre 8,1 % d’AMD
(Advanced Micro Devices), le numéro deux mondial
des microprocesseurs.
ArtParis
AbuDhabi
se
tiend du 27 au 29 novembre, sous la coupole de
l'Emirates Palace. 47 galeries internationales
représentant 17 pays y participent. 24
viennent de l'Hexagone, dont Patrice Trigano,
ou
Daniel Templon avec un «one-man-show»
de Vasarely. A ne pas manquer non plus, la galerie
allemande Frank Pages, qui montre une vidéo
de Shirin Neshat, Rapture, et les 10 exposants
du Moyen-Orient: l'iranien Silk Road se spécialise
dans la photo et Albareh Art, de Bahreïn,
présente Ali Hassan, artiste du Qatar.
Rens.: 01-42-18-09-42. Et www.artparis-abudhabi.com
Art
Paris-Abou Dhabi, un face-à-face
de cultures
 «
Que la créativité soit un
moteur de vie. » C’est ce qu’a
déclaré cheikh Mohammad
el-Khalaf al-Mazroui, porte-parole de
l’Adach (haute autorité responsable
du développement de la culture
et de la préservation de l’héritage
à Abou Dhabi). C’était
lors d’une conférence de presse
donnée à l’hôtel
« Emirates Palace », la veille
de l’inauguration de la foire Art
Paris Abou Dhabi.
«
Que la créativité soit un
moteur de vie. » C’est ce qu’a
déclaré cheikh Mohammad
el-Khalaf al-Mazroui, porte-parole de
l’Adach (haute autorité responsable
du développement de la culture
et de la préservation de l’héritage
à Abou Dhabi). C’était
lors d’une conférence de presse
donnée à l’hôtel
« Emirates Palace », la veille
de l’inauguration de la foire Art
Paris Abou Dhabi.
Cette foire d’art moderne et contemporain
retrouve le golfe Arabique pour la seconde
année consécutive.
Sous la prestigieuse coupole de l’Emirates
Palace, plus de cinquante-neuf galeries,
exposant des artistes de plus de 22 pays,
se sont installées dès le
17 novembre. Inaugurée par Son
Altesse cheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan,
cette foire, qui se déroulera jusqu’au
21 novembre, est une plate-forme de dialogue
entre les cultures orientale et occidentale.
En effet, si les salles d’exposition
enregistrent une augmentation de 40 %
de fréquentation par rapport à
l’an dernier, on note par ailleurs
une recrudescence de l’art venu des
pays du Moyen-Orient. Cette région
du monde offre aujourd’hui une opportunité
fantastique de découvrir de nouveaux
artistes, avec une vision originale parfois
radicalement différente de tout
ce qu’on a l’habitude de voir
en Occident. « Le M-O possède
un grand potentiel de talents qui n’attendent
qu’à être connus »,
dit Caroline Clough Lacoste, directrice
d’Art Paris Abou Dhabi. « On
assiste au même phénomène
en Chine, en Inde ou en Australie et les
collectionneurs ou curateurs sont attentifs
au développement de ces régions
», poursuit-elle.
Pour Bassam Terkawi, directeur général
de TDIC (société pour le
développement et l’investissement
du tourisme), Art Paris entre dans le
cadre d’un programme éducatif
et culturel qui aura certainement des
ramifications futures dans ce domaine-là.
Tom Krens, ancien directeur du Musée
Guggenheim de Bilbao et conseiller pour
la construction du même musée
à Abou Dhabi, considère
qu’Art Paris serait comme un pont
qui mènerait vers différentes
directions. « Quand Bilbao a été
construit, a-t-il dit, c’était
une utopie et lorsque je suis arrivé
il y a trois ans à Abou Dhabi,
l’Emirates Palace était vide.
Aujourd’hui, il grouille d’activités
et il confirme ce dialogue qui existe
entre les cultures. » En faisant
le tour des galeries, de nombreux talents
interpellent par leurs œuvres et
leur créativité. Comme un
terreau fertile, ils n’attendaient
qu’à être découverts.
Art Paris Abou Dhabi est une occasion
unique pour que le monde connaisse ces
nouveaux venus dans le paysage artistique.
Qui sait si ces talents ne peupleront
pas les murs des musées de demain
à Abou Dhabi, ou ne mettront pas
leurs efforts en commun pour travailler
à la muséographie de ces
grandes institutions artistiques qui vont
voir le jour à partir de 2011 dans
cette cité des Émirats.
Art Paris n’expose pas seulement
à l’intérieur, mais
à l’extérieur également.
Dans le jardin de ce fabuleux palace de
mille et une nuits, les sculptures ont
pris place attirant les visiteurs et invitant
à la ballade. Le monumental Art
Garden avec notamment le Caterpillar de
Wim Delvoye (présenté par
la galerie Guy Pieters, Belgique) et la
Corazza, gigantesque sculpture en bronze
d’Igor Mitoraj (de Die Galerie, Allemagne).
Par ailleurs, dans cette seconde édition
où Picasso côtoie l’artiste
algérien Yazid Oulab et Ramin Haerizadeh
avoisine Chagall, on assiste à
l’émergence de nouveaux talents
venus d’Inde, d’Iran et du Liban.
Une foire qui défie la crise financière
à laquelle fait face le monde et
qui appelle à la fois à
la créativité et au dialogue.
Bilan
et perspectives d’une grande foire
artistique

Quatre mille cinq cent personnes, dont
de nombreux collectionneurs, curateurs
et
amateurs d’art, ont convergé
vers l’« Emirates Palace »
pour assister à l’ouverture
de la deuxième
édition d’artparis-Abou Dhabi.
Un rendez-vous devenu incontournable.
Après l’inauguration officielle
du Salon qui s’est déroulée
en présence de Son Altesse cheikh
Sultan bin Tahnoon al-Nahyan, avec la
participation de personnalités
françaises, notamment Marie Laure
de Villepin, Cécilia et Richard
Attias, Dominique Baudis, président
de l’Institut du monde arabe, et
d’autres figures du monde de l’art,
plus de 12 000 visiteurs et collectionneurs
ont déambulé entre les stands
de 59 galeries internationales et dans
les allées du Monumental Art Garden,
installé sur la terrasse de l’Emirates
Palace. Cela représente une augmentation
d’environ 30% en terme de fréquentation,
puisqu’ils étaient 9200 visiteurs
l’année dernière.
Collaborant étroitement avec les
autorités culturelles (Adach) et
touristiques (TDIC) d’Abou Dhabi,
les organisateurs d’artparis-Abou
Dhabi, Caroline Clough Lacoste, Laure
d’Hauteville et Henri Jobbé-Duval,
ont confirmé leur volonté
de prendre activement part au développement
culturel d’Abou Dhabi en instaurant
un dialogue fécond entre galeries,
artistes et collectionneurs du Moyen-Orient
et de l’Occident.
Dans un contexte économique touché
mondialement par la crise, artparis-Abou
Dhabi a généré des
transactions en faveur d’artistes
internationaux, principalement du monde
arabe où s’est profilé
un vif intérêt pour les artistes
moyen-orientaux. Pour Laure d’Hauteville,
ayant vécu plus de quinze ans au
Liban et habituée donc aux foires
d’art libanaises, « la présence
des stands arabes a pour objectif de mettre
en avant les grands artistes émergents
et d’illustrer l’avancée
culturelle du Moyen-Orient». «L’art
arabe, souligne-t-elle, n’a pas fait
ombrage aux grandes signatures, mais il
est à présent plus difficile
d’acquérir des œuvres
de plusieurs millions d’euros qu’une
œuvre contemporaine arabe qui vaut
moins cher (entre dix et trente mille
dollars) et certaines galeries ont joué
la carte du métissage, comme Trigano
qui exposait les œuvres orientales
et occidentales. » « Les frontières
s’ouvrent donc à artparis-Abou
Dhabi et les gens communiquent, poursuit
Laure d’Hauteville. Les musées
qui sont en train de se construire ne
peuvent démarrer s’il n’y
a pas un marché de l’art.
Celui-ci ne peut exister que par l’intermédiaire
d’une foire qui offre un large panorama
de l’art. Notre objectif est qu’Abou
Dhabi soit formé de 50% d’œuvres
des pays arabes et 50% d’occidentales
tout en maintenant la qualité,
et nous sommes déjà prêts
pour l’an 2009. »
ABOU DHABI,
de Colette KHALAF
>> Le Club de
femmes francophones d'Abou Dabi
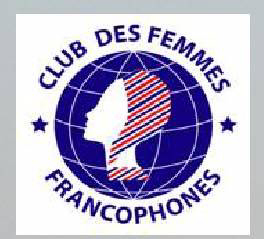
|
Abou
Dhabi voit grand: Louvre, Sorbonne, salons et
expositions...
l’Émirat multiplie les réalisations.
Et ne lésine pas sur les moyens.
Lire
la suite... >>
|
Mars
2008: la semaine francophone à Abou Dhabi
Une première édition réussie
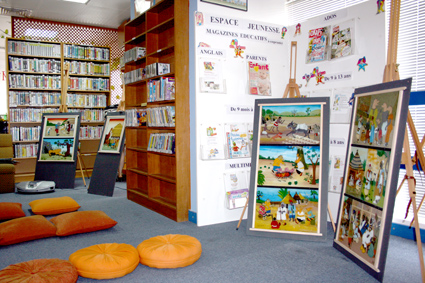
Baptême
des mots et de la francophonie pour Abou Dhabi qui s’est
ouverte à la culture au cours de trois journées
qui se sont déroulées sous le haut patronage
de cheikh Hamdan ben Zayed al-Nahyan, vice Premier-ministre,
sous l’impulsion de Hoda al-Khamis-Kanoo, fondatrice
du Abu Dhabi Music and Arts Foundation, et grâce
à l’énergie de la curatrice Rita
Saab Moukarzel. Abdou Diouf, secrétaire général
de la francophonie, a donné le coup d’envoi
de l’événement, en français
dans le texte, rejoint par de nombreuses personnalités
francophones qui ont animé la scène culturelle
du 16 au 19 mars.
Abou
Dhabi. La ville est accueillante, animée par
les derniers préparatifs d’un événement
inédit?: la semaine francophone. Dans son désir
de construire des ponts virtuels et d’amitié
pour que la diversité des cultures puisse se
retrouver en toute harmonie, la cité a réuni
culture, musique et art autour d’invités,
écrivains, philosophes, caricaturistes, peintres,
producteurs de cinéma, parfaits ambassadeurs
de la langue française.
Coup d’envoi le 16 mars, à l’occasion
d’une soirée d’inauguration, à
la fois discrète et élégante, à
l’Emirates Strategic Center, fondé en 1994
par cheikh Mohammad ben Zayed al-Nahyan. Au cours de
cette cérémonie, cheikh Nahyan Moubarak
al-Nahyan, ministre de l’Éducation supérieure
et de la Recherche scientifique, et cheikh Hamdane ben
Zayed al-Nahyan, représentant du Premier ministre,
ont pris la parole pour décrire l’éveil
culturel d’Abou Dhabi, qui se fait dans un esprit
de paix et de compréhension entre les peuples.
Et cela, en présence de l’ambassadeur de
France, Patrice Paoli,?et de Mongi Bousnina, directeur
général de l’Alesco.
Dans son allocution, Abdo Diouf n’a pas manqué
de souligner sa fierté de se trouver dans ce
pays «?foyer d’une renaissance intellectuelle
remarquable, symbole d’ouverture culturelle sur
le monde, vecteur de dialogue illustré par la
présence en ces lieux d’institutions prestigieuses
comme la représentation de l’Université
de la Sorbonne, le musée du Louvre et le musée
Guggenheim?».
En remettant, pour la première fois, le «
Prix de la traduction Ibn Khaldoun-Léopold Sédar
Senghor en sciences humaines », créé
par l’Alesco, à l’équipe du
Centre de recherche et de coordination scientifiques
(Cercos), pour la traduction en français de l’ouvrage
de Mohammad Abel al-Jabri,?La raison politique en islam
hier et aujourd’hui (remarquable travail qui s’est
fait sous la supervision du professeur Ahmed Mahfoud),
Diouf a précisé?: «?Voilà
la formidable magie du texte qui demeure le lieu et
le moyen le plus sûr de forger les âmes
qui animeront le monde de demain, riche de sa diversité
culturelle et linguistique.?» Et de conclure?:?«?L’équipe
du Centre de recherche et de coordination, qui entre
aujourd’hui dans le palmarès du Prix de
la traduction Ibn Khaldoun-Léopold Senghor, nous
a livré cette œuvre. À nous de savoir
bénéficier de cette moisson qui illustre
la diversité culturelle et son acceptation.?»
Un trophée a été remis au lauréat,
ainsi qu’aux invités et intervenants de
cet événement culturel. L’inauguration
a été suivie d’un cocktail autour
de l’exposition des œuvres de Nja Mahdaoui,
plasticien du signe tunisien, diplômé de
l’Académie des arts de Santa Andréa
de Rome et de l’École du Louvre, et membre
du jury international du Grand prix des arts de l’Unesco.
«?C’est une chance et un honneur d’exposer
quelques-uns de mes travaux artistiques ayant trait
au métissage du signe dans le cadre de ce débat
civilisateur.?»
Table
ronde
Les journées francophones ont véritablement
démarré le lendemain, sous le signe de
la culture et de la musique, avec une table ronde autour
du thème?: «?L’art francophone comme
vecteur de la communication?». Dans son mot d’introduction
dit en français, fait suffisamment rare pour
le souligner, la cheikha Shamma bint Sultan ben Khalifa
al-Nahyan a précisé?: «?En tant
que jeune Émiratie, ma capacité à
m’exprimer, lire et écrire en français
m’a ouvert les portes du monde francophone, de
l’art, de la musique, de la littérature
et même des sports. Je suis convaincue que la
compréhension de cette culture me permet de construire
des ponts et de faciliter les échanges entre
les Émiratis et la culture française.?»
Diane de Bellescize, modératrice mais également
professeur agrégée des facultés
de droit à l’Université du Havre,
chargée d’enseignement à l’Université
Paris 2 Assas et responsable des échanges internationaux
à l’Institut français de presse,
des DESS de journalisme à Beyrouth, Moscou et
Le Caire, a lancé le débat en s’adressant
à Joseph Maïla, ancien recteur de l’Institut
catholique de Paris et directeur du Centre de recherche
sur la paix à Paris, lui demandant d’intervenir
sur l’art de la médiation «?qui conduit,
précise-t-elle, à la négociation
et la communication?».
«?J’ai eu l’occasion, dit Maïla,
à l’Organisation internationale de la francophonie,
de participer à nombre de sorties de crises.
J’ai appris certaines choses portées par
la philosophie des institutions francophones et notamment
qu’il y a un médiateur là où
il y a un conflit. Et que, pour sortir de ce conflit,
qui est plus important que le médiateur, il faut
d’abord l’accepter. Regarder la crise en face
et l’assumer, c’est commencer à la
résoudre. C’est la loi de la démocratie.
Le conflit n’est jamais objectif. Une fois assumée
la visibilité de ce conflit, il faut changer
le regard porté sur l’autre. Les appréhensions
des uns et des autres sont les mêmes, les douleurs
se retrouvent et les angoisses aussi. Enfin, dans une
médiation, on donne à chaque acteur la
possibilité de devenir le faiseur de sa propre
histoire.?»
Pour le député Salah Honein, à
qui il a été demandé d’intervenir
sur l’art dans le discours politique, «?la
politique a pour objectif de faire évoluer une
société vers la démocratie, la
liberté, l’ouverture et la justice. Le discours
politique, basé sur la forme et le fond, est
un moyen de promouvoir ces idées et de les appliquer.
Le fond doit être honnête et la forme porteuse.
Tout discours doit être rassembleur, dynamique
et actif. Il doit surtout aboutir à une application.
L’homme politique doit être jugé sur
les résultats de son action.?»
Le philosophe Benoît Peeters, théoricien,
critique, romancier et spécialiste d’Hergé,
a développé la relation entre le texte
et l’image. «?La bande dessinée peut
être un vecteur important de la francophonie,
un véritable dialogue culturel.?» Reprenant
les albums de Tintin et notamment Le Lotus Bleu, il
rend hommage à Hergé, précurseur
et visionnaire, qui, dans les années 30, illustrait
déjà parfaitement le dialogue et l’échange
réussi entre deux cultures si différentes,
bousculant tous les stéréotypes et les
appréhensions d’actualité. Revenant
également sur Les Cités obscures, célèbres
bandes dessinées qu’il crée en collaboration
avec François Schuiten, il confirme qu’«?à
travers ce médium souple, sans grands moyens
financiers, nous pouvons faire exister un espace, un
monde, à travers des techniques très libres.?»
Salem Brahimi (fils du diplomate algérien Lakhdar
Brahimi), producteur de cinéma, venu présenter
le film Mon Colonel?dans le cadre de ces journées
francophones, a tenu pour sa part à souligner
la difficulté de faire coexister le verbe et
l’image, en affirmant que «?résister
c’est créer, créer c’est résister?».
Nja Mahdaoui a partagé son expérience
de métissage artistique dans la concrétisation
d’une œuvre commune avec un artiste québécois,
une «?cohabitation sur une même œuvre?»
dont il a pu découvrir les possibilités
et les limites. Plantu, célèbre caricaturiste
au quotidien Le Monde et créateur en 2007 de
la fondation Cartooning for Peace, a confirmé
l’importance de l’humour dans la caricature,
ne pouvant s’empêcher d’illustrer ses
propos et de revenir sur son expérience personnelle
avec cet outil aujourd’hui dangereux. «?La
caricature, c’est une manière de faire du
bien là où ça fait mal. Notre première
langue à tous, c’est l’image. Le boulot
d’un caricaturiste est de montrer quelque chose
de spontané et qui va à l’essentiel.?»?«?Il
y a, conclut-il avec un large sourire, un temps pour
pleurer et un temps pour critiquer. »
Le musicien et pédagogue Éric Preterre,
spécialiste de jazz, a appris, dit-il, à
écouter au cours de ses voyages. Revenant sur
une expérience vécue à Abou Dhabi
avec des élèves étudiant le français
comme langue étrangère et qui ont prêté
leur voix à l’enregistrement d’un recueil
de neuf chansons réunies dans un CD et un spectacle
sur l’environnement, intitulés Planète
en danger, il affirme, satisfait?: «?Dans ce projet
d’une année, modeste et ambitieux, initié
et dirigé par le Bureau de coopération
pour le français et l’ambassade de France,
nous avons développé la communication
et le dialogue au détriment du professionnalisme?»,
avant d’inviter l’assistance à une
représentation donnée le soir même
à la Fondation culturelle d’Abou Dhabi.
Le journaliste français Aurélien Colly,
qui travaille à RFI et France 24, a, quant à
lui, signalé le rôle de la francophonie
et des médias français dans la définition
d’un espace alternatif qui permettrait aux autres
cultures d’exister.
Enfin, et pour clôturer une table ronde où
le dialogue s’est illustré par sa diversité
et sa qualité, Patrice Paoli a conclu en faisant
rimer francophonie et polyphonie?: « La parole
est le début de l’action, qui reste l’une
des vertus de la francophonie. Commencer à dire,
c’est commencer à agir.?»
La première journée s’est achevée
sur un sentiment de satisfaction générale.
La francophonie a trouvé sa place d’honneur
à Abou Dhabi.

La semaine francophone à Abou Dhabi
Journées langue française,
cinéma et arts plastiques
Après la cérémonie
d’inauguration et la table ronde organisée
autour du thème «? L’art francophone
comme vecteur de la communication?», la semaine
de la francophonie s’est poursuivie dans un même
souci de qualité, mettant à l’honneur
la langue française, le cinéma et la peinture.
Mardi
18 mars.
Pour sa deuxième journée, Abou Dhabi s’enrobe
d’une délicieuse francophonie que tous les
invités savourent avec un plaisir partagé.
Au programme?: une conférence de Benoît
Peeters sur le thème «?Demain la langue
française?» et la projection du film Mon
Colonel, réalisé par Laurent Herbié,
en présence du producteur Salem Brahimi.
L’écrivain belge Benoît Peeters, théoricien
et critique, qui était intervenu la veille en
tant que spécialiste d’Hergé et cocréateur
des bandes dessinées Les Cités obscures,
a repris le thème de l’exposition «?Tu
parles !? Le français dans tous ses états?»,
dont il fut le commissaire en 2000, la faisant suivre
d’un ensemble comprenant un DVD et un livre. «?Nous
avions choisi les villes de Lyon, Bruxelles, Québec
et Dakar pour confirmer que Paris n’est pas le
centre obligé de la francophonie?», a souligné
Peeters en guise d’introduction. En projetant l’extrait
d’un des films tournés un peu partout dans
le monde, intitulé Les francophones du bout du
monde, il a tenu à «?faire entendre les
couleurs de la langue française?». Roumains,
Malgaches, Japonais, Américains, Iraniens, Cambodgiens
y témoignent d’une même voix leur
attachement à cette langue. Le ton est vite donné,
gorgé de clins d’œil et teinté
d’humour. Pour illustrer ses réflexions
sur la situation actuelle de la francophonie, Benoît
Peeters a critiqué le «?pragmatisme mondialisant?»,
qui tient à mettre la langue anglaise face au
français, presque contre. «?On dit que
la première est la langue des affaires, de l’informatique,
la langue “up to date”, “trendy”,
chic. Alors que la seconde est celle de l’Académie
et celle du rap?; celle du TGV, de la diplomatie et
des droits de l’homme.?» Parce que ce sont
les langues qui sont à défendre et pas
le français, «?il faut, précise-t-il,
arrêter de tenir le discours de la citadelle assiégée
et défendre la diversité linguistique,
celle des langues oubliées, menacées de
disparition, pour aller vers un régime de coexistence
linguistique…?» Il serait bon, également,
selon l’écrivain, de sortir du purisme de
la langue française, cette «?hypertrophie
de la langue grammaticale?» qui, se préoccupant
trop du juste, a de la difficulté à se
forger de nouveaux mots. «?Avant de se demander
si on est dans la correction, il faut d’abord le
dire !?» Reprenant des mots anglophones liés
à l’ère de l’informatique, Peeters,
non sans humour, rappelle que, comme l’ont fait
les Québécois qui ont accompagné
la naissance de ce phénomène, remplacer
software par logiciel, walkman par baladeur, e-mail
par courriel et spam par pourriel résonne comme
une évidence. «?Il faut, conseille-t-il
enfin, mélanger pragmatisme, volontarisme et
écoute, et garder un rapport ouvert et créatif
avec la langue. La réinventer, comme une langue
curieuse des autres, ouverte aux autres et désirable.?»
Projection
Désirable, cette langue francophone le fut, tout
au long de ces journées particulières.
La projection du film Mon Colonel, écrit par
Costa-Gavras et Jean-Claude Grumberg, réalisé
par Laurent Herbiet d’après le roman éponyme
écrit par Francis Zamponi, avec Robinson Stévenin,
Olivier Gourmet, Cécile de France, Bruno Solo
et Charles Aznavour, a été introduit par
l’un des producteurs, l’Algérien Salem
Brahimi. «?Après les mots, a-t-il précisé,
parlons de la guerre.?» Et plus précisément
la guerre d’Algérie, la torture et les «?pouvoirs
spéciaux?». «? Ce film, à
la fois thriller et film politique, psychologique et
historique, est franco-algérien. Il n’aurait
pas été possible sans l’Algérie,
sa population, sa communauté artistique, ses
autorités civiles et militaires. Il n’aurait
pas été possible, non plus, sans la France.
Costa Gavras et son épouse Michèle, Pathé,
le Centre national du cinéma et l’Île
de France… Durant le financement, la préparation
et le tournage de ce film, le monde et notre équipe
aussi regardaient avec stupéfaction et désolation
l’histoire que nous racontions se répéter?:
une armée d’occupation envoyée là
où elle n’avait aucune raison d’être,
laissée à ses propres excès par
un pouvoir politique désespéré
de “pacifier” par quelque moyen que ce soit
et qui commençait à justifier l’injustifiable…
L’histoire ne se répète pas…
elle avance… et on apprend ensemble… et on
impressionne un peu de pellicule… pour ne pas oublier…?»,
conclut-il.
Arts
plastiques
Le dernier rendez-vous de cette semaine francophone,
fixé pour le mercredi 19 mars, s’est organisé
autour des arts plastiques. Trois expositions se sont
déroulées à l’Alliance française
d’Abou Dhabi, en l’honneur de Léopold
Sédar Senghor?: «?Gueule de lion et sourire
du sage?», réalisée et diffusée
par l’Organisation internationale de la francophonie,
qui a réuni une série d’affiches
illustrant la vie et l’œuvre du grand poète.
Et «?La belle histoire de Leuk-le-lièvre?»,
superbe conte pour enfants imaginé par un Senghor
inspiré. Soit 55 planches qui ont illustré
le livre et, d’autre part, 20 peintures sur plaques
de verre fixées sur bois, inspirées de
ce même conte et réalisées par des
artistes africains.
La semaine francophone s’est ainsi achevée
sur une impression de réussite, laissant derrière
elle une envie d’encore plus. Encore plus de culture
et de rencontres de qualité, tant pour les organisateurs
que pour les intervenants et les participants. Cette
première édition, qui a semé ses
grains, espère récolter, sur le long terme,
une francophonie transformée en langage naturel.
ABOU DHABI, de Carla HENOUD pour L'Orient-Le Jour de
Beyrouth
UN MIRAGE NOMMÉ ABU DHABI
Avec
quatre futurs musées, des projets architecturaux
et hôteliers vertigineux, mais aussi un patrimoine
naturel méconnu, Abu Dhabi s'avère la destination
phare de demain. Visite d'une capitale vers laquelle tous
les regards convergent.
Un
ballet d'hélicoptères tournoie dans le
ciel délavé d'Abu Dhabi. Direction l'Emirates
Palace Hotel, sur la pointe Ras al-Akhdar de l'île.
La Main Gate (inspirée de notre Arc de triomphe,
sic !), réservée aux hôtes d'exception,
aspire un flot de berlines rutilantes, tandis que la
pelouse latérale tient lieu de piste d'atterrissage.
Des essaims d'hommes en blanc et de femmes en noir déambulent
dans le lobby pharaonique. Le palace de tous les superlatifs,
autoproclamé 7 étoiles, accueille ce mardi
de décembre un mariage princier. La famille royale
célèbre l'union d'un des siens, Cheikh
Mohammed Ben Hamdan Ben Zayed al-Nahyan, avec la fille
du Dr Cheikh Sultan Ben Khalifa al-Nahyan. Deux al-Nahyan
? Rien d'exceptionnel : les Emiriens - qui ne représentent
que 13 à 15 % de la population de leur pays -
se marient de préférence entre eux, a
fortiori lorsqu'ils portent un nom célèbre,
nous dit-on. Les al-Nahyan exercent leur autorité
à Abu Dhabi depuis 1690. Deux d'entre eux ont
donné leur nom aux deux avenues principales d'Abu
Dhabi : le plus célèbre, Zayed al-Nahyan
le second, qui fut le père fondateur des Emirats
arabes unis (EAU) - le 2 décembre 1971 - et son
président jusqu'à sa mort en 2004 ; ainsi
que son grand-père Zayed al-Nahyan le Grand,
qui fit bâtir sur un édifice du XVIIIe
le fort Blanc et ses remparts, ancien palais des cheikhs
que Wilfred Thesiger décrit, dans Le Désert
des déserts, comme « un grand château
dominant la petite ville en ruine qui s'étirait
du rivage. Il y avait là quelques palmiers et,
non loin d'eux, un puits où nous abreuvâmes
nos chameaux. » C'était en 1948. Aujourd'hui,
rare vestige historique de la ville - la légende
raconte qu'il protégeait la source d'eau qui
fut à l'origine de la fondation d'Abu Dhabi -,
le fort al-Hosn se tient timidement à l'ombre
d'une forêt de buildings. Le plus haut, l'Adia
Tower, un bâtiment de verre et d'acier, inauguré
en 2007 pour accueillir le quartier général
des services d'affectation des revenus du pétrole,
culmine à 200 mètres de hauteur.
Du
sommet de la tour voisine, on a bien du mal à
imaginer qu'avant 1958 - date de la découverte
de l'or noir -, cette ville debout n'était qu'un
minuscule village de pêcheurs de perles. Là
où se dressaient leurs cabanes ensablées,
là où les bédouins se déplaçaient
à dos de dromadaire, se trouve actuellement la
Corniche, une belle promenade de 6 kilomètres
ponctuée de squares, de cafés, et bordée
de tours et de mosquées. Abu Dhabi recense plus
de 900 de ces dernières. La plus fameuse, la
grande mosquée Cheikh Zayed vient d'être
achevée après sept années de travaux.
L'édifice est somptueux. Une partie du monument
sera accessible aux non-musulmans, qui pourront ainsi
admirer ses colonnes incrustées de pierres précieuses
et son fabuleux tapis iranien de 6 000 m2, le plus grand
du monde. Un des plus jolis points de vue pour la photographier
est incontestablement la terrasse de la piscine de l'hôtel
Shangri-La. Ouvert fin 2007, le palace oscille entre
profusion et charme orientaux. Ses élégants
restaurants chinois, vietnamiens et français
accueillent le Tout-Abu Dhabi.
Le
soir, il est très couru de venir y fumer la chicha.
Les belles Emiriennes, luxueusement vêtues sous
leurs abayas noires (« un vêtement culturel
et non religieux », précisent-elles en
choeur) jouent langoureusement avec leurs voiles. Pour
croiser des Emiriennes et leurs familles, inutile de
déambuler dans les rues - on ne se promène
pas en centre-ville, il n'y a rien de charmant à
découvrir sous une chaleur caniculaire -, rendez-vous
dans les centres commerciaux de la capitale : le Marina
Mall et l'Abu Dhabi Mall, de préférence
en fin d'après-midi. Le sport préféré
des Emiriennes, avant le ladies'club, est invariablement
le shopping. Marie-Christine de Warenghien, une «
expat' » cultivée devenue prof de français,
puis guide officielle d'Abu Dhabi, le confirme : «
A chaque session, lorsque je demandais à mes
élèves pourquoi elles voulaient apprendre
le français, elles répondaient à
l'unisson "for shopping !" » Fatima,
une étudiante rencontrée à la Sorbonne-Abu
Dhabi - université mixte de langue française
créée par un accord de coopération
entre Paris IV et le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche des EAU - acquiesce
: « Ça fait chic de parler le français
; c'est prestigieux. » Les ressortissants de l'Hexagone
sont ainsi plutôt bien accueillis. Mais que faire
à Abu Dhabi, excepté du shopping aux malls
ou à l'Heritage Village, pour les souvenirs,
et profiter des infrastructures et des plages de l'Emirates
Palace et du Shangri-La ? Passer une demi-journée
à buller sur l'île de Lulu ; swinguer sur
le green (de sable en l'occurrence) de l'al-Ghazal Abu
Dhabi Sand Golf ; découvrir le chantier et le
port des Dhows, à deux pas des souks aux poissons,
aux fruits et légumes, aux dattes... Les travailleurs
indiens et pakistanais y construisent encore des bateaux
en bois selon la tradition séculaire. «
Mais c'est sûr, commente Mohammed, un Marocain
expatrié, pour m'amuser, je préfère
aller à Dubaï, tandis que pour vivre au
calme, en famille, je préfère Abu Dhabi.
Ici, il y a une vingtaine de parcs et jardins, et moins
d'embouteillages. Dubaï, c'est la démesure,
alors qu'Abu Dhabi, c'est la capitale émirienne
et fédérale, avec ses administrations,
ses ambassades... et une véritable ambition de
capitale culturelle du Moyen-Orient. » Comme l'attestent
l'île de Saadiyat (signifie bonheur en arabe)
et ses quatre futurs méga-musées prévus
pour 2011-2012 : le Louvre de Jean Nouvel, le Guggenheim
de Frank Gehry, le Centre des arts vivants de Zaha Hadid
et le musée de la Mer de Tadao Ando, qui ont
fait couler beaucoup d'encre. L'Emirates Palace accueille
une très belle expo consacrée à
ce projet. En revanche, l'île de Saadiyat n'est
aujourd'hui qu'un chantier. Inaccessible. Qu'à
cela ne tienne, une myriade d'îles naturelles,
au large des 400 kilomètres de côtes de
l'émirat, sanctuaires des tortues vertes et des
dauphins, constituent des réserves naturelles
protégées, notamment pour des espèces
ornithologiques menacées, bien plus attrayantes.
Certaines de ces îles furent peuplées dès
l'Antiquité, telle Sir Bani Yas.
Ne
quittez pas Abu Dhabi sans une excursion à al-Ain,
la verdoyante oasis qui vit naître Cheikh Zayed.
Son marché aux chameaux, son camélodrome
et son Musée archéologique méritent
le détour. Les amoureux des dunes skieront sur
le sable ou admireront le coucher du soleil. Les plus
chanceux pousseront jusqu'à l'oasis de Liwa,
par le désert de Roub al-Khali, « le quartier
vide ». Au train où vont les chantiers
du pays, il ne le restera peut-être plus très
longtemps !
MARIE-ANGÉLIQUE OZANNE pour Le FIGARO
3
bonnes (et belles) raisons de découvrir
Abou Dhabi
L'autre
mégapole des Emirats est en passe d'éclipser
Dubaï, sa rivale. Atolls déserts,
campements sauvages, promesses de musées
fabuleux: une destination à explorer.
En pionnier. Lire
la suite... >>>
|